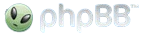Le Sénat, siégeant au Palais du Luxembourg à Paris, non élu par le peuple et obstacle aux transformations des institutions, ce garant de l’immobilisme gagnerait pourtant à évoluer — voire, tout simplement, à disparaître.
À l’origine, le Conseil des Anciens, ancêtre du Sénat, fut mis en place en 1795 après l’exécution de Robespierre. La France passait alors d’un système monocaméral à un système bicaméral. Autrement dit, le pouvoir de créer des lois n’était plus détenu par une seule assemblée représentante du peuple (désignée au suffrage universel), mais partagé entre un parlement populaire élu au suffrage censitaire — seuls ceux qui s’acquittaient d’impôts pouvaient voter — et le Conseil des Anciens.
Ce dernier était élu au suffrage censitaire indirect, par de grands électeurs capables de payer une taxe très lourde. Pour simplifier, les membres de cette chambre étaient choisis par les plus aisés parmi les encore plus riches. Elle avait pour mission d’accepter ou de refuser les lois proposées par l’autre assemblée. Une façon, pour la bourgeoisie de l’époque, de verrouiller le système à son avantage et d’éviter toute radicalité.
Or, plus de deux siècles plus tard, le Sénat représente toujours un reliquat de cette époque. S’il n’a certes plus le pouvoir de bloquer les lois de l’Assemblée nationale, il est cependant encore désigné par suffrage universel indirect. En d’autres termes, ses membres sont choisis par de grands électeurs — à savoir des élus locaux — et non par l’ensemble des Français.
Sociologiquement, ces grands électeurs sont connus pour leur conservatisme et ne représentent pas fidèlement l’ensemble du peuple. Ce fonctionnement favorise également les partis politiques très implantés localement. Depuis l’instauration de la Cinquième République, le Sénat a presque toujours été contrôlé par la droite et le centre, à l’exception d’une courte période entre 2011 et 2014 où la gauche a obtenu la majorité.
Au vu de ces circonstances, on pourrait penser qu’il est urgent de changer ce mode de scrutin afin que cette assemblée reflète davantage la diversité du peuple. À titre d’exemple, le Rassemblement national ne compte que quatre sénateurs, et La France insoumise aucun, alors que ces deux partis représentaient à eux deux près de 45 % des voix lors de la dernière présidentielle.
Toutefois — et c’est là que ce système devient pernicieux — pour faire évoluer le mode de désignation des sénateurs, il est nécessaire de modifier la Constitution. Celle-ci, dans son article 24, stipule en effet que : « Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois cent quarante-huit, est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République. »
Or, pour procéder à un changement de la Constitution, il faut soit l’approbation des deux chambres (Sénat et Assemblée) suivie d’un référendum, soit l’accord des 3/5 du Congrès (députés et sénateurs réunis), soit 555 parlementaires. À moins d’obtenir quasiment l’unanimité de l’Assemblée nationale (577 élus), il est donc nécessaire de convaincre une partie des sénateurs eux-mêmes. Or, la majorité d’entre eux — en particulier à droite — s’y oppose farouchement. En effet, pourquoi remettraient-ils en cause un système qui les avantage autant ?
Mais au-delà de son mode de désignation contestable, le Sénat dispose aussi de pouvoirs très limités sur le plan législatif. Les deux chambres — Assemblée et Sénat — ainsi que le gouvernement peuvent proposer des lois. Ces propositions naviguent d’une chambre à l’autre pour y être examinées jusqu’à obtenir un accord.
En cas de désaccord, une commission mixte paritaire, composée de sept députés et sept sénateurs, est constituée. Si un compromis est trouvé, la loi est validée par les deux chambres. Si ce n’est pas le cas, l’exécutif peut alors demander à l’Assemblée nationale (Palais Bourbon) de trancher en dernier ressort.
S’il ne le fait pas, la proposition de loi est tout simplement abandonnée. En conséquence, le Sénat n’a aucun pouvoir d’imposer une décision au gouvernement ou à l’Assemblée. Par ailleurs, une loi sans l’aval du Premier ministre n’a quasiment aucune chance d’aboutir.
Le véritable rôle du Sénat consiste, en réalité, à protéger la Constitution de la Cinquième République. Comme expliqué plus tôt, il est très difficile de modifier ce texte fondamental sans son accord. De fait, une majorité conservatrice au Sénat empêche toute tentative de réforme profonde de la Constitution.
Certains juristes avancent cependant qu’il serait difficile, politiquement, de résister à un référendum constitutionnel. En 1962, Charles de Gaulle en avait organisé un contre l’avis du Parlement, renforçant ainsi ses propres pouvoirs. Cette solution pourrait donc représenter une porte de sortie crédible.
Quoi qu’il en soit, en posant régulièrement des propositions de lois réactionnaires sur la table, le Sénat influence l’opinion publique, nourrit les médias et freine toute idée progressiste.
Par ailleurs, le fonctionnement du Palais du Luxembourg coûtera encore 359 millions d’euros au contribuable en 2025. En 2023, il disposait aussi d’une réserve financière de 1,9 milliard d’euros, destinée notamment à financer les retraites des anciens parlementaires. Des sommes certes modestes à l’échelle de l’État, mais qui pourraient symboliquement être redirigées vers des services publics plus utiles à la nation.
N’avoir qu’une seule assemblée n’a rien d’extraordinaire : de nombreux pays fonctionnent ainsi. Certains, comme la Suède, ont même supprimé leur chambre haute (en 1971).
On pourrait aussi redonner au Sénat son rôle de filtre démocratique, en le transformant en une véritable assemblée du peuple. Il pourrait ainsi être composé de membres tirés au sort, pour contrebalancer le pouvoir des élus, souvent proches des élites économiques. Ce parlement citoyen aurait toute latitude pour débattre des projets de loi, les bloquer ou les inscrire à une liste de propositions soumises à référendum.
Un tel processus renforcerait le contrôle citoyen et protégerait les Français des abus de leurs représentants. Il permettrait alors d’en finir avec une assemblée bourgeoise, conservatrice, qui ne défend — au fond — que ses propres intérêts.
Mais pour en arriver là, il faudrait d’abord rompre avec la Cinquième République. Charge à chacun d’entre nous de se saisir de cette question.